Concevoir
Résumé de section
-
-
Vous pouvez écouter la version audio de cette section ci-dessous.
-
Des travaux académiques nativement accessibles
Les logiciels de traitement de texte offrent la possibilité de construire un document nativement accessible*. Voici quelques pistes simples pour y parvenir.
Pour identifier facilement le document et son contenu :
- Précisez les propriétés du document : un nom de fichier et un titre de document courts et explicites avec une langue prédéfinie.
Pour faciliter la lecture :
- Utilisez des polices d’écriture simples et sans empattement, comme Calibri, Arial, Verdana ou Tahoma.
- Accentuez les majuscules.
- Évitez l’utilisation abusive des caractères en italique et en gras.
- Évitez le soulignement qui coupe certaines lettres (g, j, p, q, y).
- Évitez les césures.
- Utilisez les notes de bas de page avec parcimonie.
- Déclinez les sigles lors de leur première mention et recensez-les dans une liste.
- Contrastez les couleurs utilisées dans les illustrations.
- Si vous utilisez une couleur pour véhiculer une information, prévoyez une alternative pour rendre l’information accessible.
- Pour les énumérations, utilisez des listes à puces.
- Rendez les notes cliquables.
- Rendez les liens URL actifs.
- Structurez* votre fichier, hiérarchisez les titres et intertitres (Titre 1, Titre 2…) en veillant à leur cohérence et générez un sommaire automatique et interactif.
- Proposez des textes alternatifs aux objets non textuels (illustrations, diagrammes, schémas…).
- Pour les tableaux, limitez les cellules fusionnées. Pour les tableaux complexes, rédigez un résumé décrivant l’organisation spatiale des données.
- Indiquez une légende avant chaque tableau ou illustration. Dans les options d’export vers le PDF, veillez à conserver les balises* d’accessibilité et proposez des signets de navigation*.
-
Bon à savoir : Les ressources de la Direction interministérielle du numérique* (DINUM) détaillent pas à pas les étapes pour rédiger un contenu accessible (traitement de texte, diaporama, tableur…).
Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre structure et échanger avec la personne référente en matière d’accessibilité numérique. Lors de la soumission de votre article, discutez avec votre éditeur et porteur de revue des questions d’accessibilité de vos travaux.
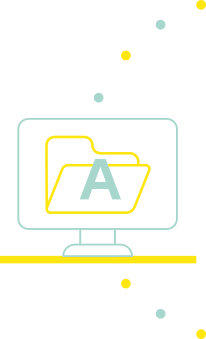
-
En pratique
Ma thèse portait sur l’effet spectral de la couleur de la lumière dans la photosynthèse du phytoplancton. Pour mon premier article, j’ai adapté la palette des couleurs pour les rendre accessibles aux personnes ayant des troubles de la vision, ce qui a permis d’élargir son lectorat. La structuration des documents a été d’une aide précieuse lors de la rédaction de mes travaux académiques de la licence jusqu’à la thèse. Elle facilite la relecture et certaines tâches comme la création des tables de contenus.
Produire des textes décrivant des illustrations n’est pas un prolongement de l’ouvrage, mais une alternative nécessaire afin d’élargir son lectorat. C’est un exercice qui force à extraire d’une illustration ce qui en est essentiel : une bonne occasion de réfléchir au sens des illustrations, au rôle qu’on souhaite leur voir jouer dans un texte. -
Science ouverte et accessibilité, des objectifs communs
Vous pouvez écouter la version audio de cette section ci-dessous.
Les principes FAIR au prisme de l’accessibilité universelle
Dans une optique de science ouverte, les principes FAIR invitent à rendre les données :
- faciles à trouver : renseigner leurs métadonnées*, dont les informations d’accessibilité, afin de permettre leur recherche (par auteur, titre…) ;
- accessibles : un stockage ouvert favorise une consultation facile sur une archive institutionnelle ou dans une bibliothèque, sans entrave technique ;
- interopérables : l’utilisation de langages et de formats standardisés ouverts permet aux données et métadonnées d’être compatibles avec les outils d’assistance technologique. Cf. https://doranum.fr/stockage-archivage/quiz-format-ouvert-ou-ferme_10_13143_mcwq-qs64 ;
- réutilisables : les conditions de réutilisation doivent être précisées dans une licence. Lorsque celle-ci est ouverte, elle permet d’éviter les conflits techniques d’accessibilité.
Les principes FAIR rejoignent ainsi parfaitement les principes et les objectifs de l’accessibilité universelle. La qualité des métadonnées s’avère un enjeu central dans les deux cas ; par-delà le handicap ou tout autre obstacle technique ou économique, c’est la diffusion du savoir et la progression de la recherche scientifique qui sont en jeu.
-
Code et accessibilité numérique
Le code source de vos recherches peut donner lieu à la création d’un logiciel avec interface visuelle, d’une application ou d’un site web. Lorsque vous concevez ce code source, vérifiez que le résultat répond aux règles recommandées par le Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA*). Dans le cas d’une page web, ce référentiel est découpé en 106 critères relevant de treize catégories. Par exemple, pour rendre un formulaire accessible, des tests ainsi que la sémantique HTML à respecter y sont renseignés. Un code conforme permet de rendre le contenu accessible aux technologies d’assistance.
Bon à savoir : Si vous participez à la production d’un site web, vous pouvez vérifier l’accessibilité d’une partie des contenus, via l’outil WAVE (https://webaim.org/techniques/acrobat) ou sur experte.com (https://www.experte.com/fr/accessibilite).
-
