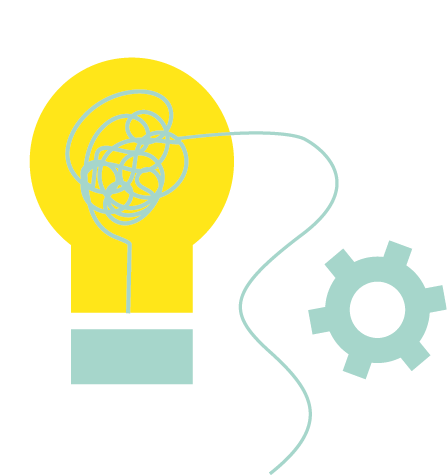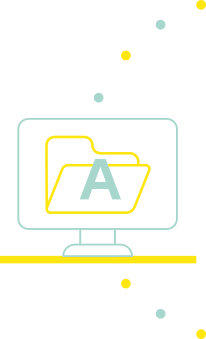Mémoires, thèses, publications : SOYONS ACCESSIBLES !
Résumé de section
-
Le livret "Soyons accessibles" vise à aider les étudiants et les chercheurs à intégrer la question de l'accessibilité dans leurs travaux scientifiques, tels que mémoires, thèses et publications.
Ce livret contient des informations contextuelles et pratiques, des définitions, des témoignages, ainsi que des liens utiles pour vous accompagner dans votre démarche d'accessibilité.
Cette page est la version web du livret réalisé sous la direction du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Ce livret est en libre accès !
Aucune création de compte ou d'inscription n'est nécessaire, toutefois vous ne pourrez le parcourir qu'en lecture seule.
Pour participer au forum, vous devez vous inscrire au cours.
S'inscrireMis à jour : Octobre 2023
Public : Mastérants, Doctorants, Chercheurs
Auteur : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Licence : BY-SA 4.0
-
-
731.8 Ko
-
311.1 Ko
-
363.1 Ko
-
435.7 Ko
-
-
-
Ce forum est à votre disposition pour échanger sur le sujet et nous faire par de vos retours sur ces productions.
-