Résumé de section
-

Citer un document et rédiger une bibliographie
Cette section vous accompagne dans la maîtrise des techniques de citation. À travers six vidéos, vous découvrirez les règles de citation directe et indirecte, l'utilisation des appels de citation, l'organisation rigoureuse des bibliographies et les spécificités de la citation d'images.
6 vidéos
-
Citer un document
Après avoir exploré les dangers du plagiat et de la contrefaçon, cette vidéo vous guide vers la solution : l'art de citer correctement ses sources. Loin d'être une simple contrainte administrative, la citation bibliographique constitue le pilier fondamental de l'intégrité scientifique et académique.
Découvrez pourquoi la citation n'est pas un "truc pour vous embêter" mais un outil essentiel qui valorise votre travail en montrant la profondeur de vos recherches. Nous explorerons les quatre rôles majeurs de la citation : transparence et vérifiabilité, facilitation du repérage des sources, identification et localisation des documents, et respect du droit de propriété intellectuelle.
Cette introduction pratique vous présente les concepts clés - appels de citation, bibliographie, styles bibliographiques - et vous guide dans le choix parmi les plus de 10 000 styles existants. Une base solide pour maîtriser les règles académiques et transformer la contrainte en atout pour vos travaux universitaires.
Citer un document - Marie Latour (YouTube)
Transcription - Citer un document
Introduction : L'importance de citer ses sources
Utiliser des documents sans citer la source d'où ils proviennent, on l'a vu, c'est du plagiat. Et une rupture de copyright, c'est même carrément de la contrefaçon. Pourtant, réutiliser des documents existants dans le cadre d'un travail scientifique est non seulement encouragé, mais surtout indispensable. Mais alors, comment éviter le délit de plagiat ? Comment éviter une condamnation pour contrefaçon ? Une seule solution : il faut citer ses sources. Mais pas n'importe comment, puisqu'il s'agit de le faire dans le respect des règles académiques.
Les objectifs de ce cours sont doubles. Il s'agit d'abord de vous aider à comprendre pourquoi citer ses sources est important, voire même, je dirais indispensable, dans le cadre d'un travail académique. Il s'agit ensuite de vous expliquer les grandes lignes du fonctionnement de la citation scientifique.
Les quatre rôles majeurs de la citation bibliographique
Même si vous avez globalement compris que ne pas citer ses sources menait tout droit vers le délit de plagiat, vous pouvez, au final, vous demander si la citation bibliographique ne sert finalement pas juste à montrer patte blanche au niveau légal, en vous contraignant à un travail aussi inutile que laborieux. Et si vos enseignants conspiraient dans le seul but de vous embêter ? Non, en fait, la citation bibliographique occupe un rôle clé dans le processus scientifique, en assurant notamment la vérifiabilité des assertions avancées. On peut identifier quatre rôles majeurs.
Premièrement, la citation bibliographique vous permet de présenter vos sources en toute transparence. Elle montre le sérieux de votre travail et atteste de vos recherches approfondies. Elle témoigne de la confrontation de votre réflexion avec celle de vos prédécesseurs. Ainsi, loin de vous desservir, elle donne du cachet à votre travail. Elle facilite aussi la vérifiabilité de votre travail, en permettant à votre lecteur de retrouver vos sources et d'en vérifier la fiabilité et la pertinence.
Ah, mais vous allez me dire, c'est encore un truc pour mieux nous évaluer, ça ? Non, pas vraiment, car toute la communauté scientifique, chercheurs compris, s'astreint à ce système. Il est le garant de la transparence de la science et par là, de sa réfutabilité qui se trouve au cœur de ses principes.
Deuxièmement, la citation bibliographique, et notamment la fameuse bibliographie finale, permet de donner une idée des publications parues sur un sujet. Elle facilite entre les chercheurs le travail de repérage des sources sur un domaine ou un sujet donné. Les chercheurs, lorsqu'ils consultent un document qui leur paraît fiable et pertinent sur leur sujet, vont souvent consulter sa bibliographie finale pour y trouver d'autres références. C'est d'ailleurs un sage conseil que je vous invite à appliquer pour vos propres recherches.
Troisièmement, à partir de là, la bibliographie permet l'identification et la localisation des documents utilisés. C'est pourquoi il est indispensable de suivre des normes communes qui permettent la reconnaissance facile des documents par une présentation standardisée des références.
Et enfin, bien sûr, la citation bibliographique permet de respecter le droit de la propriété intellectuelle et permet une utilisation juste et équitable du document. Rendons à César ce qui est à César, et par honnêteté et éthique intellectuelle, ne nous enorgueillissons pas de découvertes qui ne sont pas les nôtres. L'éthique doit être replacée au cœur même du processus scientifique.
Les outils de la citation bibliographique
Dans les communautés scientifiques, deux outils se complètent pour permettre la citation bibliographique. Il s'agit d'abord de l'appel de citation, qui est une marque repère insérée dans le corps du document pour montrer qu'il y a eu citation, justement. Et il s'agit ensuite de la bibliographie, qui s'insère à la fin du document ou dans certaines disciplines, au fil de l'eau, dans les notes de bas de page.
Les styles bibliographiques
Pour homogénéiser les citations bibliographiques au sein d'un document, on va utiliser ce qu'on appelle un style bibliographique. Un style bibliographique, c'est une présentation standardisée, souvent reconnue internationalement, d'une bibliographie. Au total, il existe plus de 10 000 styles bibliographiques dans le monde. Les plus connus sont par exemple le style APA (American Psychological Association), ou encore Chicago ou encore Vancouver.
Il existe également plusieurs versions de ces styles bibliographiques qui sont régulièrement mis à jour. Le style bibliographique s'applique à la fois aux appels de citations et à la bibliographie finale.
Comment choisir son style bibliographique
Mais parmi ces plus de 10 000 styles bibliographiques existants, lequel choisir ? Le style bibliographique à utiliser peut vous être imposé par votre encadrant de mémoire ou de thèse, ou par votre filière ou par votre enseignant. Renseignez-vous bien ! Dans le cadre de la recherche, ce sont souvent les revues qui imposent un style bibliographique particulier aux chercheurs.
Une fois que vous avez trouvé votre style bibliographique, tenez-vous-y. Ne mélangez surtout pas les différents styles entre eux. Et enfin, on ne le répétera jamais assez, suivre un style bibliographique demande une grande rigueur, que ce soit dans la rédaction des appels de citations, des éventuelles notes de bas de page ou encore de la fameuse bibliographie.
Où trouver les styles bibliographiques
Mais où peut-on trouver ces fameux documents si précieux, que sont les styles bibliographiques ? Il faut savoir que certains styles bibliographiques sont fondés sur des normes AFNOR ou des normes ISO et qu'à ce titre, leur consultation est payante. Mais si un style bibliographique vous est prescrit, vous pouvez essayer de le demander à votre encadrant de mémoire, à votre enseignant, à votre encadrant de thèse.
Chaque style fait aussi l'objet d'une publication sous forme de livre imprimé. Essayez de vous rendre à votre bibliothèque universitaire pour le consulter ou même l'emprunter. Enfin, vous pouvez essayer aussi d'en trouver une version gratuite sur Internet.
Exemple de différences entre styles
Cet exemple vous montre les différences de présentation entre plusieurs styles bibliographiques parmi les plus connus. Vous les voyez énumérés en colonne 1. Vous voyez les différences entre les appels de citations de ces différents styles en colonne 2 et en colonne 3, vous voyez les différences entre les références dans la bibliographie finale. Si les données bibliographiques à insérer sont globalement les mêmes, vous voyez que les présentations peuvent être très différentes entre elles.
Conclusion
Voilà, vous savez tout, enfin, presque tout, sur les bases de la citation de documents. Pour entrer plus précisément dans le détail, n'hésitez pas à regarder les vidéos suivantes.
Résumé - Citer un document
-
Introduire une citation bibliographique
Maintenant que vous comprenez l'importance de citer vos sources, passons à l'action ! Cette vidéo vous guide pas à pas dans l'art délicat de l'insertion des citations bibliographiques dans vos documents académiques. Loin d'être une simple formalité, chaque type de citation obéit à des règles précises qui garantissent la clarté et l'intégrité de votre travail.
Découvrez les deux modes fondamentaux de citation - directe et indirecte - et leurs codes de présentation spécifiques. Apprenez à distinguer citation directe courte (avec guillemets) et longue (en retrait et italique), maîtrisez les techniques de modification d'extraits avec crochets et points de suspension, et évitez les pièges de la citation indirecte.
Transcription - Introduire une citation bibliographique
Introduction : Comment insérer des citations bibliographiques
Vous avez compris que pour éviter le plagiat, il faut citer ses sources. Vous êtes à présent sur le ring, prêt à en découdre. Vous ouvrez votre logiciel de traitement de texte. Et là, oh, misère ! Comment est-ce qu'on introduit une citation bibliographique déjà ? À l'issue de cette vidéo, vous saurez comment insérer correctement des citations bibliographiques dans vos documents, selon le type de configuration dans laquelle vous vous trouvez.
Les deux modes de citation
Il existe deux manières de citer un extrait de document dans un écrit académique. La première est appelée citation directe. Elle consiste à reproduire mot pour mot, un extrait de texte lu ou entendu pour appuyer son propos. On reproduit dans ce cas très exactement l'extrait cité, sans en changer la moindre lettre.
La seconde manière de citer est appelée citation indirecte. Dans ce cas de figure, on doit résumer les propos du document original avec ses propres mots. Ce sont là deux modes de citation très différents, dont il convient de respecter les codes de présentation respectifs sans les mélanger. Leur alternance permet d'ajouter de l'élégance stylistique à vos écrits. Ces modes de citation sont tout aussi légitimes, l'un que l'autre. Et surtout, ils sont complémentaires.
La citation directe courte
Commençons par nous intéresser au mode de citation directe. À l'intérieur de la citation directe, une distinction doit encore être faite entre la citation directe dite « courte » et la citation directe dite « longue ». La différence entre les deux s'effectue en comparant la longueur de l'extrait choisi au sein de l'œuvre citée par rapport à la longueur de l'œuvre citante finale. C'est une notion qui laisse place à la subjectivité, mais, avec un peu d'honnêteté intellectuelle, il est assez facile de distinguer les deux cas de figure.
Lorsqu'on insère une citation directe courte, on doit absolument placer l'extrait que l'on reproduit entre guillemets. Il faut alors reproduire textuellement, mot pour mot, l'extrait en question, sans en changer une seule lettre ou une seule virgule. À la fin de la citation, on insère ce que l'on nomme un « appel de citation » sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Ne mettez jamais d'italique à la citation directe courte.
Prenons l'exemple d'un extrait de l'article suivant que l'on voudrait citer : « Des cultures foncièrement différentes : usage de la terre chez les Amérindiens et les migrants haïtiens en Guyane » publié en 2018 par deux anthropologues guyanais, Marianne Palisse et Damien Davy, à la page 163 du numéro 202 de la revue Études Rurales. L'extrait que nous empruntons est le suivant : "La situation foncière de la Guyane demeure particulière puisqu'environ 96,6% de sa superficie appartient au domaine de l'État."
Il existe des conventions particulières pour l'introduction d'une citation directe. La première méthode consiste à utiliser une phrase d'introduction telle que "Marianne Palisse et Damien Davy expliquent que" que l'on ponctue de deux points. On ouvre alors les guillemets et on note la citation directe en la faisant débuter d'une majuscule. Puis, on referme les guillemets et on termine en ajoutant l'appel de citation.
Exemple
Marianne Palisse et Damien Davy expliquent : "La situation foncière de la Guyane demeure particulière puisqu'environ 96,6% de sa superficie appartient au domaine de l'État." (2018, p.64)
L'autre méthode consiste à insérer la citation dans la logique de la phrase. Dans notre exemple, on écrira une petite phrase d'introduction telle que « Marianne Palisse et Damien Davy expliquent que… » Et comme si la citation venait naturellement à la suite, on ajoute après avoir ouvert les guillemets, l'extrait cité sans mettre de majuscule. Enfin, on ferme les guillemets et on ajoute l'appel de citation.
Exemple
Marianne Palisse et Damien Davy expliquent que "la situation foncière de la Guyane demeure particulière puisqu'environ 96,6% de sa superficie appartient au domaine de l'État" (2018, p.64).
La citation directe longue
Toutefois, vous pouvez aussi être amené à effectuer des citations plus longues d'extraits exacts de documents. Les codes pour marquer la citation directe longue sont très différents de ceux de la citation directe courte. Dans ce cas-là, vous ne devez surtout pas ouvrir les guillemets. Vous devez aller à la ligne et créer un paragraphe spécifique pour la citation. Décalez légèrement les marges de ce paragraphe à gauche et à droite, par exemple, en marquant un retrait de 2 cm de part et d'autre, et ajoutez votre extrait en italique.
Vous pouvez voir ici un exemple de citation directe longue. D'abord, on a introduit le propos : "Marianne Palisse et Damien Davy sont deux chercheurs en Guyane. En comparant la situation de cette dernière à celle d'Haïti, ils ont constaté dans leur article nommé « Des cultures foncièrement différentes : deux manières d'appréhender la réalité » :" Puis, on met deux points et on va à la ligne. On marque un retrait de paragraphe à gauche et à droite. Puis on reproduit entièrement l'extrait cité en le mettant en italique. Enfin, on ajoute l'appel de citation.
Une fois la citation terminée, on retourne à la ligne, on enlève les italiques et le retrait de marge et on continue à rédiger son document.
Exemple
Marianne Palisse et Damien Davy sont deux chercheurs en Guyane. En comparant la situation de cette dernière à celle d'Haïti, ils ont constaté dans leur article Des cultures foncièrement différentes deux manières d'appréhender la réalité :
Aujourd'hui, la situation foncière de la Guyane demeure particulière puisqu'environ 96,6 % de sa superficie appartient au domaine de l'État. Les élus des collectivités locales se plaignent du fait que leur absence de maîtrise du foncier limite leur marge de manœuvre et leurs initiatives en matière de développement. C'est dans ce contexte que vont s'inscrire les demandes d'accès au foncier de divers groupes de population. Celles des Amérindiens et des migrants haïtiens empruntent des voies différentes (2018, p.164).
Les modifications d'extraits cités
Il peut cependant arriver que, pour des raisons stylistiques, on soit obligé de tronquer ou de modifier légèrement l'extrait cité. Cette opération doit être exécutée avec beaucoup de prudence afin que cela n'altère et ne change le sens du propos initial. De fait, trois cas de figure peuvent se présenter.
Premier cas de figure : la partie de citation
Vous souhaitez ne citer dans votre document qu'une partie de la phrase qui a été écrite, souvent une expression particulière ou un groupe de mots. Dans ce cas, la partie de l'extrait en question est insérée dans votre texte sans majuscule et entre guillemets, ainsi que le montre l'exemple.
Exemple
La situation de la Guyane est particulière : « environ 96,6 % de sa superficie appartient au domaine de l'État » (Palisse, M. & Davy, D., 2018, p.164).
Deuxième cas de figure : ajout ou modification de mots
Toujours pour des raisons stylistiques, vous avez besoin d'ajouter ou de modifier quelques mots de l'extrait original cité. Dans ce cas, on encadre les mots ajoutés ou modifiés de crochets. Par exemple, dans l'article original de Marianne Palisse et de Damien Davy, les auteurs ont utilisé l'expression « sa superficie ». Mais pour des raisons grammaticales, on devrait plutôt utiliser l'article « la », car ce à quoi le groupe de mots se rapporte, « la Guyane », n'a pas été mentionné auparavant. On doit donc changer l'article « sa » en l'article « la ». Pour marquer la modification, on encadre le déterminant « la » entre crochets.
Puis on continue d'écrire la citation. Et là, on se heurte à un deuxième problème. Pour que l'on comprenne bien ce dont on parle, on doit ajouter le groupe de mots « de la Guyane ». Afin de bien montrer qu'il s'agit d'un ajout qui ne figurait pas dans le texte original, on place à nouveau ce terme entre crochets. Puis on termine d'écrire notre citation. On achève notre citation en fermant les guillemets, puis en insérant l'appel de citation à la fin.
Exemple
Marianne Palisse et Damien Davy estiment que « 96,6 % de [la] superficie [de la Guyane] appartient au domaine de l'État ». (2018, p.164).
Troisième cas de figure : omission de mots
À présent, imaginons, toujours pour des raisons stylistiques, que nous ayons besoin d'enlever certains mots de la citation. S'il y a omission d'un mot ou d'un groupe de mots au milieu ou à la fin d'une même phrase, on doit l'indiquer par le signe « trois points de suspension » placé entre parenthèses et non entre crochets. Nous voyons très bien dans l'exemple suivant où se situe l'omission.
Exemple
En Guyane, Marianne Palisse et Damien Davy estiment que « [la] situation foncière (...) demeure particulière puisqu'environ 96,6 % de sa superficie appartient au domaine de l'État » (2018, p.164).
La citation indirecte
Passons maintenant à la citation indirecte. Elle consiste à résumer un passage ou un livre entier avec ses propres mots ou à reformuler un extrait précis d'un document. La citation indirecte dispose de ses propres codes qui diffèrent notablement de ceux de la citation directe. Une très mauvaise pratique consisterait à reproduire un extrait exact, même en modifiant quelques petites expressions à la marge, et à le faire passer pour de la citation indirecte. Les deux modes de citation ne doivent pas être confondus, ni mélangés.
Lorsque l'on effectue une citation indirecte, on ne doit surtout pas ouvrir les guillemets, reproduire l'extrait mot pour mot, donner la page du document où on a trouvé l'extrait, mettre le passage en italique ou opérer un quelconque changement de police, de taille ou de couleur de caractère. Le seul marqueur de la citation indirecte est l'appel de citation qu'il vous faut absolument insérer à la fin pour éviter le plagiat, ainsi que vous le montre l'exemple qui s'affiche.
Exemple
La particularité foncière de la Guyane, dont 96,6% de la superficie appartient à l'État, complexifie la mission de développement des collectivités locales, ainsi que l'accès au foncier des différentes populations locales (Palisse, M. & Davy, D., 2018).
Conclusion
Voilà, vous savez tout, ou presque tout, sur les manières d'introduire une citation bibliographique dans un écrit académique.
Résumé - Introduire une citation bibliographique
-
Insérer un appel de citation
Après avoir vu les techniques de citation directe et indirecte, il est temps de vous familiariser avec l'appel de citation. Ces petits marqueurs discrets constituent le lien entre votre texte et vos sources, permettant au lecteur de distinguer clairement vos idées personnelles des emprunts à d'autres auteurs.
Cette vidéo détaille les appels de citation dans leurs deux formes principales : par auteur (nom, date) et par numéro, selon le style bibliographique choisi. Vous découvrirez les règles spécifiques à chaque type de citation - directe avec numéro de page, indirecte sans page - et apprendrez à adapter vos appels selon que les auteurs sont mentionnés ou non dans votre introduction.
Transcription - Insérer un appel de citation
Introduction : Qu'est-ce qu'un appel de citation ?
Nous avons dit dans la vidéo précédente que le premier élément de la citation bibliographique était l'appel de citation. Comment ? L'appel, quoi ? Vous n'en avez jamais entendu parler de votre vie ? C'est plutôt normal. Mais vous allez vite vous rendre compte à quel point cet élément de citation est indispensable. À l'issue de cette vidéo, vous saurez définir ce qu'est un appel de citation, reconnaître les différents types d'appels de citation, insérer un appel de citation dans un écrit académique et différencier l'appel de citation de l'appel de note.
Lorsque vous écrivez un document académique, le risque, c'est qu'on ne différencie pas très bien ce qui relève de votre pensée personnelle de ce qui a été emprunté à un autre texte, ce qui peut conduire au plagiat. Pour clarifier la situation pour le lecteur, on a inventé les appels de citations. Les appels de citations sont des marqueurs que l'on ajoute à la fin des citations pour permettre au lecteur de les identifier comme tels. Ils renvoient à des références bibliographiques complètes qui sont listées dans la bibliographie finale, ce que nous aurons l'occasion de voir dans une prochaine vidéo.
Les deux types d'appels de citation
Il existe deux types d'appels de citations qui sont définis par le style bibliographique que vous utilisez :
- Les appels de citations par auteur
- Les appels de citations par numéro
Les appels de citation par auteur
Commençons d'abord par les appels de citations par auteur. Ceux-ci peuvent prendre la forme suivante :
Premièrement, si les auteurs de la citation ne sont pas mentionnés dans l'introduction de la citation bibliographique, on note entre parenthèses les noms du ou des auteurs, suivis d'une virgule, suivi de la date d'édition du document. C'est la situation la plus courante.
Deuxièmement, si les auteurs de la citation sont mentionnés dans l'introduction de la citation, on note entre parenthèses la date d'édition du document uniquement.
Troisième cas possible, lors d'une citation directe, et uniquement dans ce cas-là, on ajoute aux autres informations des cas 1 ou 2, que l'on vient d'énoncer, la page du document d'où provient la citation.
Les autres règles autour des appels de citation, comme le nombre d'auteurs que l'on doit mentionner à l'intérieur des parenthèses, ou la nécessité ou pas de mentionner aussi les prénoms de ces derniers, dépendent complètement du style bibliographique que vous avez choisi.
Exemples d'appels de citation par auteur
On peut voir, dans ce premier exemple, comment les appels de citation par auteur ont été insérés à la fin des citations. Dans le premier exemple, les noms des auteurs de l'article ne sont pas précisés dans l'introduction de la citation. L'appel de citation comprendra donc entre parenthèses le nom des deux auteurs, ici Marianne Palisse et Damien Davy, sous le format Nom, Virgule, initial du prénom, Virgule, puis on insère la date du document, à nouveau une virgule, et comme il s'agit d'une citation directe, on ajoute le numéro de la page à laquelle on a trouvé cette phrase dans le document original.
Exemple 1
On note toutefois que « la situation foncière de la Guyane demeure particulière puisqu'environ 96,6 % de sa superficie appartient au domaine de l'État » (Palisse, M. & Davy, D., 2018, p.164).
Le deuxième exemple est un cas de citation indirecte. On insère l'appel de citation à la fin de la citation. Comme les noms des auteurs ne sont pas mentionnés dans celle-ci, on écrit entre parenthèses les noms des auteurs sous le format nom, virgule, initial du prénom, puis on ajoute une virgule, on note la date du document et on ferme la parenthèse. On ne rajoute surtout pas le numéro de page qui n'est présent que dans le cas de citation directe.
Exemple 2
La particularité foncière de la Guyane, où 96,6 % de sa superficie appartient à l'État, complexifie la mission de développement des collectivités locales, ainsi que l'accès au foncier de différentes populations locales (Palisse, M. & Davy, D., 2018).
Cas concret d'appels de citation par auteur
Prenons un cas concret trouvé dans un vrai article scientifique. Vous pouvez voir ici deux exemples d'appels de citations par auteur qui ont été insérés dans le texte du document.
Exemple
Cet article se propose de dépasser le point de vue « classique, traditionnel » qui consiste à prendre comme point de départ de l'analyse des relations entre pratiques des élèves et français enseigné à l'école, celui du « locuteur natif ». Un point de vue qualifié par J. Cenoz et D. Gorter (2011) de « biais monolingue » au sens où les compétences linguistiques de l'élève sont considérées uniquement du point de vue d'une (supposée) unique première langue de première socialisation dans son rapport avec une (supposée, elle aussi) unique langue de scolarisation. Il propose en outre de changer de regard sur l'analyse des productions des élèves qui ne sont pas considérées ici du point de vue d'un écart par rapport à la langue de scolarisation, le français, mais comme la trace d'une compétence plurilingue mise au service des apprentissages. Ce qui en soit nous intéresse n'est donc pas tant l'écart des productions des élèves par rapport à la norme attendue à l'école que la manière dont on amène les élèves vers cette norme en partant de leurs compétences déjà-là, de leurs pratiques linguistiques et sans avoir pour objectif la disparition de ces compétences. Il s'agit donc bien ici de considérer les élèves non pas comme « étant limités » mais bien comme des « bilingues émergents » (Garcia 2009 : 322) pour lesquels les compétences langagières et linguistiques sont autant d'atouts pour apprendre la langue de scolarisation et pour lesquels le français devient une ressource supplémentaire dans leur répertoire linguistique (et non pas une ressource qui viendrait supplanter ou remplacer les ressources déjà-là).
Dans le premier exemple, les auteurs ont été introduits avant la citation. L'appel de citation se manifeste juste par une date, 2011, notée entre parenthèses. Dans le deuxième exemple, l'auteur n'a pas été mentionné dans l'introduction de la citation. L'appel de citation est donc composé du nom de famille de celui-ci, Garcia, de la date de publication de son article, 2009, du numéro de la page à laquelle on peut retrouver les éléments repris. Vous voyez ? Ce n'est pas plus difficile.
Les appels de citation par numéro
Passons maintenant à l'autre cas d'appel de citation, que peut imposer un style bibliographique, à savoir l'appel de citation par numéro. Dans un appel de citation par numéro, les citations sont numérotées par ordre d'apparition dans le texte. Les numéros sont placés, soit entre crochets, soit entre parenthèses ou en exposant, selon le style utilisé. Les références dans la bibliographie finale sont classées par ordre chronologique de numéros. Une même référence, citée plusieurs fois dans le texte, doit toujours être associée au même numéro.
Exemple d'appels de citation par numéro
Là encore, passons au cas pratique. Dans l'extrait d'article qui s'affiche, le premier appel de citation vient en fin de citation directe sous la forme d'un numéro 1. Le deuxième appel de citation se présente exactement de la même manière, sous la forme du numéro 2. Le numéro de page n'est pas précisé, bien qu'il s'agisse d'une citation directe.
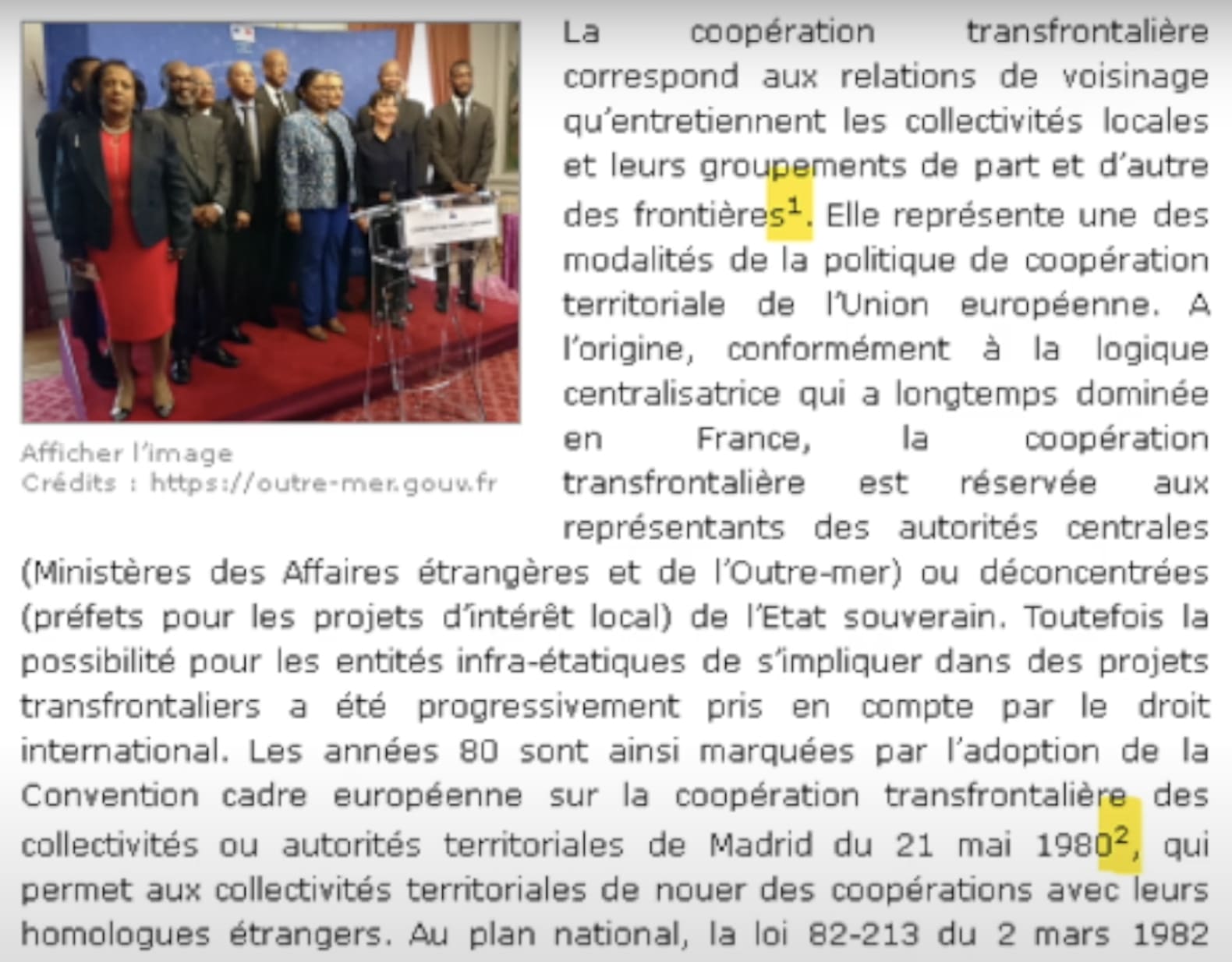
Différence entre appel de citation et appel de note
Enfin, il convient de ne pas confondre l'appel de citation avec l'appel de note. L'appel de note se place immédiatement après le mot ou le groupe de mots auquel il se rapporte et dont il n'est séparé par aucun espacement. Il précède toujours le signe de ponctuation. En fin de phrase, il est suivi du point ou d'un autre signe de ponctuation finale.
L'appel de note est un chiffre, une lettre ou un signe conventionnel tel que l'astérisque, que l'on place soit au-dessus de la ligne en exposant, soit sur la ligne entre parenthèses. L'appel de note introduit une référence bibliographique complète ajoutée en bas de page. Il est utilisé dans deux cas précis :
Premièrement, dans le cas où le style bibliographique précise que la bibliographie doit se faire au fil de l'eau dans les notes de bas de page.
Deuxièmement, dans le cas où l'on fait référence à un document qui ne figurera pas dans la bibliographie finale, comme, par exemple, pour un document primaire utilisé comme source.
Mais il faut bien reconnaître que les styles bibliographiques qui ont recours à l'appel de notes comme mode de citation sont beaucoup moins nombreux que ceux utilisant les appels de citations par auteur ou par numéro. Vous y aurez donc statistiquement faiblement recours.
Conclusion
Voilà, vous savez tout, ou presque tout, sur les appels de citations et les appels de notes.
Résumé - Insérer un appel de citation
-
Rédiger une bibliographie
Après avoir détaillé les appels de citation, il est temps de nous pencher sur le second pilier de la citation académique : la bibliographie. Loin d'être une simple liste de références ajoutée en fin de document, la bibliographie constitue un véritable répertoire organisé qui témoigne de la qualité et de la rigueur de votre travail de recherche.
Cette vidéo vous révèle les secrets d'une bibliographie réussie, évaluée selon deux dimensions complémentaires : intellectuelle et formelle. Découvrez comment sélectionner des sources fiables et pertinentes, pourquoi la diversité des types de documents est essentielle, et comment respecter scrupuleusement les exigences formelles d'un style bibliographique.
À travers des exemples concrets du style APA, vous comprendrez l'importance de chaque détail : ordre des données, ponctuation, italique, majuscules... Un niveau d'exigence qui peut paraître intimidant mais qui garantit l'identification précise de vos sources et la crédibilité de votre travail académique.
Rédiger une bibliographie - Marie Latour (YouTube)
Transcription - Rédiger une bibliographie
Introduction : Qu'est-ce qu'une bibliographie ?
Le deuxième outil de citation bibliographique est la bibliographie à proprement parler. C'est quoi cette chose ? Ça se rédige comment ? Allez, pas de panique, on vous explique. À l'issue de cette vidéo, vous saurez ce qu'est une bibliographie, et pourquoi il est important de réaliser des bibliographies soignées dans vos écrits académiques.
Une bibliographie, c'est un répertoire organisé de références bibliographiques. On a bien dit « organisé », pas un vase fourre-tout dans lequel on colle tout ce qu'on trouve.
Structure d'une bibliographie
Voici l'extrait d'une bibliographie insérée à la fin d'un article de la chercheuse Sophie Alby. La première entrée correspond à une référence bibliographique, renvoyant à un chapitre de livre.
ALBY, S. (2010). Le plurilinguisme guyanais : implications et applications pour le second degré. Dans R. Ailincaï & T. Mehinto (dir.), Pratiques éducatives dans un contexte multiculturel. L’exemple plurilingue de la Guyane (pp. 87-96). Cayenne : CRDP de Guyane.La deuxième entrée correspond à une référence bibliographique, renvoyant à un livre imprimé.
BOURCIEZ, É & BOURCIEZ, J. (1974). Phonétique française. Étude historique. Paris : Klincksieck.Et enfin, celle-ci correspond à une référence bibliographique, renvoyant à un article de revue.
CENOZ, J. & GORTER, D. (2011). A holistic approach in multilingual education : introduction. The Modern language journal, 95(3), 339-43.Vous remarquez que toutes ces références ne sont pas présentées de la même manière, selon le type de document auquel elles correspondent, car on n'a pas besoin des mêmes éléments pour retrouver et localiser un article de revue, un chapitre de livre ou encore un livre. L'écriture d'une référence bibliographique se présente donc de manière très différente pour chaque type de document.
Les données bibliographiques
Tous les éléments composant une référence bibliographique sont appelés des « données bibliographiques ». Ce sont les différents éléments dont on a besoin pour retrouver le document en question, cité dans une bibliographie. Leur présentation se fait dans un ordre précis et selon des règles précises, qui sont déterminées par le style bibliographique que vous utilisez.
Dans cette référence de livre imprimé de la bibliographie de Sophie Alby, on trouve dans l'ordre les données bibliographiques suivantes : les noms des auteurs, les initiales de leur prénom, suivi de la date de publication du livre, suivi du titre du livre, suivi de son lieu de publication, suivi de sa maison d'édition.
Dans le cadre d'un travail académique, vous devez insérer uniquement dans votre bibliographie les documents que vous avez utilisés. Et on ne gonfle pas artificiellement la bibliographie, avec des articles ou des livres jamais ouverts.
La double évaluation d'une bibliographie
La conception d'une bibliographie comprend deux facettes complémentaires, qui feront toutes deux l'objet d'une évaluation : sa conception intellectuelle, d'une part, et sa conception formelle d'autre part.
La conception intellectuelle
Au travers de votre bibliographie, l'évaluateur ou le chercheur pourra évaluer le sérieux de votre étude à travers les références apportées. Ainsi, afin de montrer que vous vous êtes appuyé sur des réflexions de qualité qui ont nourri favorablement votre propos, vous devez absolument citer uniquement des documents fiables et pertinents.
Fiables, ça veut dire des documents vérifiés et de qualité. Pertinents, ça veut dire des documents qui sont vraiment utiles pour votre étude. Vous devez donc faire un véritable travail de réflexion sur les documents que vous intégrez. Est-ce qu'ils sont dignes d'être cités ? Sont-ils en rapport étroit avec le sujet ? Vous ont-ils réellement servi ?
Et pour vous prouver que votre recherche de documentation n'a pas été lacunaire, vous devez disposer d'une grande variété de types de documents : des livres, mais aussi des articles, des rapports, des thèses et de supports, à la fois imprimés et électroniques.
La conception formelle
Vous serez également évalué sur la conception formelle de votre bibliographie, car il s'agit là d'un document normé qui doit être ordonné, hiérarchisé et respecter un style bibliographique identique du début à la fin. Les références de votre bibliographie doivent faire l'objet d'un classement minutieux sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Mais sachez déjà qu'il est rigoureusement interdit de ranger une bibliographie par type de document ou par type de support.
L'importance du style bibliographique
La présentation de la bibliographie doit respecter un style bibliographique donné. Il s'agit à la fois d'une contrainte, mais aussi d'une aide pour leur rédaction. Une contrainte parce qu'un style bibliographique impose un grand nombre de points à respecter scrupuleusement. Et une aide, parce que sans document précisant pour chaque référence les données indispensables au repérage des documents en question, et sans cette contrainte pour harmoniser leur présentation, les bibliographies seraient sans doute des documents très peu structurés qui rendraient très difficile l'identification des ressources. Or, c'est quand même là leur principale mission.
Exemple concret : le style APA
Vous voyez ici un extrait du style bibliographique intitulé « American Psychological Association » dit APA dans sa sixième édition. Ce document explique comment présenter une référence bibliographique pour chaque type de document existant. Et si vous n'en voyez que trois, l'article, le livre et le chapitre, c'est qu'il ne s'agit que d'un extrait et pas de la version complète du style.
Type de document Format de référence Article Auteur. (année). Titre de l'article. Titre de la revue, volume(numéro), pages. Article électronique (sans doi) Auteur. (année). Titre de l'article. Titre de la revue, volume(numéro), pages. Repéré à URL Article électronique (avec doi)
* privilégier le doi, lorsque disponible.Auteur. (année). Titre de l'article. Titre de la revue, volume(numéro), pages. doi: 10.1037/a0013790 ou http://dx.doi.org/10.1037/a0013790 Livre Auteur. (année). Titre du livre (édition, volume). Lieu d'édition : Maison d'édition. Livre électronique Auteur. (Année). Titre du livre (édition, volume). Repéré à URL ou doi: 10.1037/a0013790 ou http://dx.doi.org/10.1037/a0013790 Chapitre Auteur du chapitre. (année). Titre du chapitre. Dans A. Directeur (dir.), Titre du livre (édition, volume, pages). Lieu d'édition : Maison d'édition. Chapitre électronique Auteur du chapitre. (année). Titre du chapitre. Dans A. Directeur (dir.), Titre du livre (édition, volume, pages). Repéré à URL ou doi: 10.1037/a0013790 ou http://dx.doi.org/10.1037/a0013790 Le style décline la présentation des références pour chaque type de document en fonction de leur support. Elle sera légèrement différente, selon si le document consulté existe en version imprimée ou en version électronique.
L'exigence formelle des styles bibliographiques
Dans un style bibliographique, tous les éléments de présentation formelle sont importants : l'ordre d'enchaînement des données bibliographiques, la ponctuation utilisée, si la donnée comporte une majuscule ou une minuscule au début, si elle s'écrit en écriture normale ou en italique, si elle se trouve insérée entre parenthèses ou entre crochets. Le respect de ces exigences formelles doit être très minutieux et vous serez aussi évalué sur la rigueur avec laquelle vous vous y conformerez.
Par exemple, à la ligne 4 de ce style APA 7e édition, on vous indique pour le type de document livre, sous-entendu livre imprimé, que la présentation doit se faire ainsi : d'abord, le nom de l'auteur avec une première lettre majuscule et en écriture normale, suivi d'un point, suivi de l'année écrite en écriture normale et mise entre parenthèses, suivi d'un point, suivi du titre du livre écrit en italique et avec une première lettre majuscule, directement suivi, entre parenthèses, des numéros d'édition et de volume écrits en écriture normale et en minuscule, suivi d'un point, suivi du lieu d'édition, écrit en écriture normale et avec une première lettre majuscule, suivi de deux points, suivi du nom de la maison d'édition, écrit en écriture normale avec une première lettre majuscule, suivi d'un point.
Vous avez là un aperçu du niveau d'exigence formelle d'un style bibliographique auquel il faudra bien vous conformer.
Conclusion
Voilà, vous savez tout, ou presque tout, sur la rédaction des bibliographies.
Résumé - Rédiger une bibliographie
-
Organiser et classer une bibliographie
Une bibliographie bien organisée révèle instantanément la rigueur méthodologique de son auteur. Comme le dit l'adage, "un bureau rangé témoigne d'un esprit organisé" - et cette règle s'applique pleinement à vos références bibliographiques. Un enseignant expérimenté peut souvent évaluer la qualité d'un travail rien qu'en observant sa bibliographie.
Cette vidéo vous dévoile les conventions académiques qui transforment une simple liste de sources en un outil de recherche efficace. Découvrez les deux grands systèmes d'organisation - alphabétique et numérique - imposés par votre style bibliographique, et maîtrisez les huit règles fondamentales du classement alphabétique.
Transcription - Organiser et classer une bibliographie
Introduction : Pourquoi ranger sa bibliographie ?
Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous poser une petite question. Pourquoi on range dans la vie ? Généralement, pour retrouver avec facilité ses affaires et gagner du temps dans son quotidien. Vous êtes d'accord ou pas ? On dit souvent qu'un bureau rangé témoigne d'un esprit organisé. Eh bien, pour la bibliographie, c'est exactement la même chose. On doit ranger sa bibliographie pour pouvoir retrouver les références dont on a besoin, au moment où on en a besoin, et savoir où localiser les documents. Cela témoigne d'une bonne organisation et d'une méthodologie de travail efficace.
Entre nous, un enseignant est souvent capable d'attribuer une fourchette de notes à votre devoir à la seule vue de votre bibliographie. Et pour rendre le rangement efficace, on lui applique un ensemble de conventions académiques que nous allons passer en revue ensemble. À l'issue de cette vidéo, vous connaîtrez les différents types de classements d'une bibliographie et vous saurez organiser votre bibliographie selon le style bibliographique choisi.
Les deux types de classement
Dans le milieu académique, il existe deux manières d'organiser une bibliographie :
- Le classement par ordre alphabétique
- Le classement par ordre numérique
On rencontre aussi parfois une hybridation entre ces deux modèles, surtout en sciences humaines et sociales. Là encore, ce n'est pas vous qui décidez du modèle que vous allez suivre. Non, il est imposé par le style bibliographique que vous avez choisi.
Les huit règles du classement alphabétique
Commençons par passer en revue les règles d'ordonnancement d'une bibliographie classée par ordre alphabétique d'auteur. Elles sont au nombre de 8.
Règle numéro 1 : Le classement des références par ordre alphabétique d'auteur
Ça, c'est la règle générale. On classe les références par ordre alphabétique d'auteur, des documents de lettre à lettre dans le sens de la lecture. Par exemple, une autrice nommée Élodie Albi, avec un « i » à Albi, sera classée dans la bibliographie avant une autrice nommée Sophie Alby avec un « y » à Alby, car le premier élément de différenciation des deux noms, le « i », se trouve avant le « y » de la deuxième autrice.
Règle numéro 2 : Les préfixes et les particules
Pour les préfixes américains comme « Mac », il faut prendre en compte la manière dont ils sont écrits et non pas la manière dont ils se prononcent. Par exemple, un auteur nommé MacLane, écrit M-A-C, viendra avant un auteur nommé McKvitt, écrit M-C, car le « a » est placé avant le « c » dans l'ordre alphabétique.
La particule française « de » est toujours reportée après le prénom abrégé. Les particules étrangères, comme « Von » en allemand, sont généralement intégrées au nom pour le classement. Par exemple, Honoré de Balzac est rangé à la lettre B dans la bibliographie, alors que Johann Wolfgang von Goethe est rangé à la lettre V en raison de sa particule.
Enfin, les articles « le », « la », « les », « l' » font partie intégrante du nom en français. Il ne faut pas les séparer du patronyme proprement dit. Par exemple, Jean de La Fontaine est rangé à la lettre L et non pas F, comme on pourrait le penser.
Règle numéro 3 : Le même auteur, mais une date différente
Pour deux sources n'ayant qu'un seul auteur identique, on se base sur la date du document, sachant que le plus ancien est classé avant le plus récent. Par exemple, pour citer deux articles de Tina Harpin, on classera en premier son article le plus ancien datant de 2015 et, après, le plus récent, publié en 2020.
Règle numéro 4 : Plusieurs sources avec le même auteur
Lorsque le premier auteur est identique pour deux sources différentes, la source avec un seul auteur vient en premier avant la source à auteurs multiples. Par exemple, un article écrit par Marianne Palisse uniquement précédera dans la bibliographie un second article publié par cette même chercheuse, en collaboration avec Damien Davy, et ceci indépendamment de la date de publication de l'article.
Règle numéro 5 : Plusieurs sources avec plusieurs co-auteurs identiques
Lorsque des références ont un premier auteur identique, la différence se fera sur le deuxième auteur. Et si le deuxième auteur est identique, la différence se fera sur le troisième auteur, etc. Si, par exemple, on veut intégrer à sa bibliographie un premier article écrit par Marianne Palisse et Guillaume Odonne et un deuxième article écrit par Marianne Palisse, Guillaume Odonne et Marc-Alexandre Tareau, alors on classera en premier celui qui comprend seulement les deux premiers co-auteurs et en deuxième, celui écrit par les trois co-auteurs, et ceci indépendamment de la date de publication de l'article.
Règle numéro 6 : La date de publication
Si des références ont des auteurs strictement identiques, alors, on utilisera les dates de publication pour le classement de celles-ci, en commençant par les plus anciennes et en finissant par les plus récentes. Par exemple, si deux articles ont tous deux comme co-auteurs Marianne Palisse et Guillaume Odonne, on classera en premier le document le plus ancien datant de 2015 et en second le plus récent publié en 2019.
Règle numéro 7 : Le titre
Pour des sources partageant les mêmes auteurs et la même date de publication, le classement se fera grâce aux titres. Par exemple, si on doit classer dans sa bibliographie deux publications de Tina Harpin publiées la même année, alors le classement se fera dans l'ordre alphabétique des titres. Dans cet exemple, le « C » de « conférence », qui débute le titre de son premier article venant dans l'alphabet avant le « M » de « mystère », qui commence le titre de son deuxième article, on classera en premier l'article « Conférence : Prévention et politique de lutte contre les violences faites aux femmes » et en second « Mystère, cri et poésie, l'épopée des sans-voix Ultravocal et les Affres d'un défi de Frankétienne ».
Attention, cependant, les déterminants, comme « le », « la », « un », « des » ne doivent pas être pris en compte pour le classement par titre.
Règle numéro 8 : Les initiales
Lorsque des auteurs différents portent le même nom de famille, on les différencie dans le classement de la bibliographie par les initiales de leur prénom. Par exemple, un document écrit par une chercheuse nommée Linda Amiri précédera dans le classement de la bibliographie un autre article écrit par un auteur appelé Mourad Amiri, car le « L » de Linda vient alphabétiquement avant le « M » de Mourad.
Le classement par ordre numérique
Toutes ces règles s'appliquent à la classification de la bibliographie par auteur. Cependant, il existe un autre type de classement, par ordre numérique. Dans ce cas, chaque citation reçoit un numéro par ordre d'apparition dans le texte. Ces numéros, situés juste après la citation directe ou indirecte, sont placés soit en exposant, soit entre parenthèses, soit entre crochets.
Deux citations d'une même référence, situées à deux endroits différents du document, reçoivent le même numéro. Ces numéros renvoient ensuite aux références complètes des documents qui se trouvent, soit dans la bibliographie finale de l'écrit académique, soit parfois à la fin d'un chapitre ou au fil de l'eau, dans les notes de bas de page.
Conclusion
Voilà, vous savez tout, enfin, presque tout, sur les manières d'organiser une bibliographie.
Résumé - Organiser et classer une bibliographie
-
Citer une image
Les images font désormais partie intégrante des travaux académiques contemporains, qu'il s'agisse d'illustrations scientifiques, d'œuvres d'art ou de documents visuels. Mais comment appliquer les règles de citation bibliographique à ce contenu non textuel ? Cette dernière vidéo de la série vous démontre que citer une image n'est pas plus complexe que citer un texte.
Découvrez les deux approches possibles : la reproduction intégrale avec insertion dans le document (nécessitant des droits de réutilisation) et la citation simple sans reproduction (plus sûre juridiquement). Apprenez à distinguer les œuvres d'art originales, nécessitant des informations spécifiques (support, lieu de conservation), des simples images en ligne documentaires.
Citer une image - Marie Latour (YouTube)
Transcription - Citer une image
Introduction : Comment citer une image ?
Citer des textes, c'est bon, maintenant, on sait faire. Mais là, j'ai une image, comment ça se passe ? Est-ce que ce sont toujours les mêmes principes qui prévalent ? Et est-ce que j'ai le droit de reproduire l'image dans mon écrit académique ? Bon allez, on se détend. Citer une image, ce n'est pas plus compliqué que citer un texte. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment citer une image dans un style bibliographique donné.
Deux types de citations d'images
On distingue deux types de citations qui peuvent être faites d'une image dans un écrit académique.
Premièrement, une reproduction intégrale. L'image est alors insérée dans le corps du document. Cela nécessite d'avoir les droits de réutilisation sur celle-ci et de noter en dessous ses références bibliographiques complètes, ainsi que sa licence d'utilisation.
Deuxièmement, une citation simple, sans reproduction. On intégrera alors la référence complète de l'image dans sa bibliographie. Et on pourra même réaliser des appels de citations qui renvoient à elle dans le corps du document. Cet usage ne nécessite pas l'obtention des droits de réutilisation de l'image ou de l'œuvre en question.
Exemple de reproduction intégrale
Ici, on voit comment il est possible d'insérer une image dans le corps de son écrit académique. On reproduit celle-ci au milieu du texte et en dessous. On note ses références complètes en respectant la présentation du style bibliographique choisi dans cet exemple, l'APA 7e édition. On indique ensuite la licence d'utilisation sous laquelle est placée l'image. Pour cette photographie d'Iguane qui vient de Wikimedia Commons, il s'agit de la licence Creative Commons BY-SA (ShareAlike). Ceci permet de montrer à votre correcteur que vous avez bien vérifié les droits de réutilisation de l'image et que vous respectez vos devoirs vis-à-vis du droit d'auteur.
Exemple de citation simple
Ce deuxième exemple montre la référence complète ainsi que la licence d'utilisation de l'image insérée dans la bibliographie finale, sans reproduction de celle-ci dans le document. L'appel de citation est aussi construit sur le modèle du style APA 7e édition que l'on a choisi. Avec, entre parenthèses, le nom de l'auteur, suivi d'une virgule, puis de la date de l'image en question.
Deux natures d'images : œuvre d'art vs image en ligne
Attention, cependant, dans les différents styles bibliographiques, vous disposez de deux types de présentations différentes pour citer une image, selon la nature de celle-ci : l'image œuvre d'art d'une part et l'image en ligne d'autre part.
L'image œuvre d'art
En effet, l'image que vous citez ou reproduisez peut être une œuvre d'art originale au sens d'objets ou de créations esthétiques ou artistiques, y compris numériques. C'est par exemple le cas des peintures, des sculptures, des photographies artistiques, etc. Dans ce cas, la référence mentionnée doit comprendre des éléments particuliers mentionnés dans le style bibliographique, comme le format ou le support de l'œuvre, ou encore le lieu et la ville de conservation.
Dans le cas de l'œuvre, « Départ pour la Guyane, embarquement des forçats à l'île de Ré » de Francis Lagrange, célèbre peintre bagnard de Guyane, nous avons pris le soin de renseigner les données bibliographiques exigées par le style APA 7e édition pour ce type de document comme le support, il s'agit là d'une peinture, l'institution de conservation de l'original, c'est-à-dire le musée départemental Alexandre Franconie, ou encore le lieu de conservation, ici la ville de Cayenne.
Vous remarquerez que la licence n'est pas explicitement renseignée, car l'œuvre est encore sous droit d'auteur français classique. Ne pas noter la licence d'une œuvre revient par défaut à signaler que celle-ci est encore placée sous le régime de droit d'auteur classique.
L'image en ligne simple
Ces informations disparaissent lors de la citation d'une simple image en ligne, n'ayant pas fait l'objet d'une réelle volonté artistique, telle que cette photographie d'Anaconda, servant à documenter l'espèce animale dans Wikipédia. On applique alors la deuxième présentation proposée par le style bibliographique que l'on utilise, celle pour les images en ligne, et on n'oublie pas de renseigner la licence d'utilisation.
Présentation du jeu "To be in the Norm"
Et maintenant, place au jeu à nouveau. Retournez sur le site d'Ikigai à partir de la même adresse, https://ikigai.games/games/list. Descendez sur la plateforme d'Ikigai pour retrouver non pas le jeu Partyright, comme tout à l'heure, mais le jeu "To be in the Norm". La procédure est la même. Vous pouvez télécharger la version pour Windows en cliquant sur télécharger pour Windows. Vous avez ici, sur autres plateformes, le choix entre les différentes plateformes et systèmes d'exploitation proposés.
Enfin, si vous n'êtes pas titulaire des droits d'administration de votre poste, cliquez sur télécharger la version sans installateur. Vous pourrez ainsi installer le jeu sur votre machine et en le lançant, vous pourrez jouer à celui-ci. Vous vous laisserez alors guider par le tutoriel d'explication du jeu pour en comprendre les règles.
Conclusion
Voilà vous savez tout, enfin, presque tout, sur la citation d'images dans un écrit académique.
Résumé - Citer une image
-
Quiz !
-
Testez vos connaissances avec To be in the norms
Pour consolider vos apprentissages sur la citation et la bibliographie, découvrez To be in the norms, un jeu pédagogique qui transforme la rigueur bibliographique en défi ludique et stimulant.
Ce jeu d'apprentissage vous met au défi de reconstituer des références bibliographiques complètes en respectant scrupuleusement les règles de présentation. Sélectionnez une norme bibliographique (actuellement APA 7e édition) et différents types de documents (articles, livres, chapitres...), puis reconstituez dans le bon ordre tous les éléments nécessaires : données bibliographiques, ponctuation, mise en forme (italiques, majuscules...).
Modalités de jeu :
- Parties de 10 à 30 minutes adaptables selon vos besoins
- Mode solo ou en équipes jusqu'à 5 joueurs
- Possibilité d'animer de grands groupes avec plusieurs équipes simultanées
- Utilisation autonome ou intégrée dans une formation avec débrief pédagogique
Le jeu révèle immédiatement vos points forts et lacunes dans l'application des normes, permettant un apprentissage ciblé et efficace. Les enseignants membres du consortium Ikigai peuvent même créer leurs propres normes via l'éditeur intégré.
Télécharger To be in the norms
-
