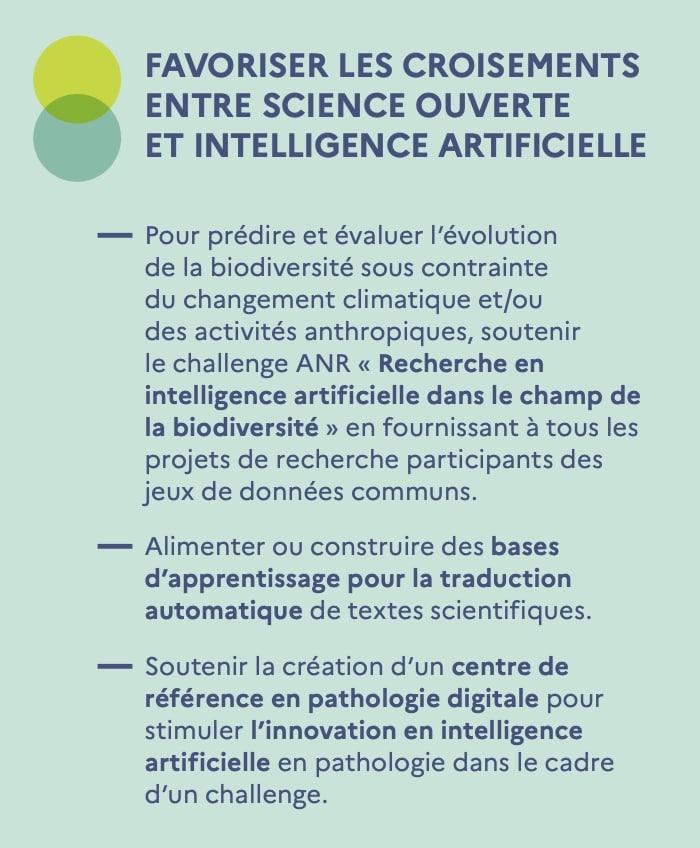Chapitre 4 : Perspectives et bonnes pratiques
Résumé de section
-
Après avoir identifié les tensions et analysé le cadre juridique, comment agir concrètement ? Ce dernier module présente les stratégies recommandées par nos experts, les exemples inspirants et les perspectives d'avenir pour une cohabitation harmonieuse entre IA et science ouverte.
10 minutes de lecture