Sciences et recherches participatives
Résumé de section
-
Les projets de science citoyenne orientés vers l'action encouragent l'intervention des participants dans les préoccupations locales, en utilisant la recherche scientifique comme un outil pour soutenir les agendas civiques.
Auteur : Raphaëlle Bats - Urfist de Bordeaux
Licence : BY_NC-SA 4.0-
Des projets scientifiques ?
Pour Wiggins et Crowston, les projets de ce type ne sont pas d'abord des projets scientifiques, mais d'abord des projets citoyens, qui nécessitent un soutien scientifique. Ainsi, écrivent-ils les chercheurs y sont "plutôt des consultants ou des collaborateurs que les initiateurs".
Pour autant, cet accompagnement scientifique n'est pas moins scientifique qu'un autre projet de recherche. Il se fait à l'initiative de la société civile, plutôt qu'à celle des chercheurs, mais requiert les mêmes méthodes scientifique que tout autre projet.
-
Organisation
Ce type de projet de science participative pose plusieurs questions en termes d'organisation :
- Qui sont les groupes locaux ?
- À quelle échelle le projet peut-il se mener ?
- Quelles passerelles pour la mise en contact entre ces groupes et les chercheurs ?
À travers ces questions, on évoquera aussi celle des financements.
-
Participants
Dans ce type de projet participatif les questions d'identification, de recrutement et de motivation des participants sont moins prégnantes que dans des projets qui démarrent dans les laboratoires. En effet, le projet qui réunit ces groupes de participants pré-existe à sa traduction en projet scientifique ou du moins académique.
Dans certains cas, les groupes de citoyens, réunis ou non en association, sont mobilisés autour d'un problème local. Wiggins et Crowston font ainsi référence à des projets qui relèvent de la préservation de territoires ruraux face à des extensions industrielles. C'est pourquoi les deux auteurs parlent d'agenda civique de ces groupes, qui s'adjoignent des chercheurs pour confirmer leurs craintes et donner des arguments tangibles pour leur plaidoyer. Ainsi dans l'ensemble des actions menées par ce groupe, ce sera, par exemple, le besoin d'identifier la faune et la flore d'un territoire rural menacé qui les amènera à contacter des chercheurs. Le groupe et ses objets d'intérêts préexistent à ce besoin méthodologique et scientifique.
Dans d'autres cas, le groupe initiateur est aussi porteur d'une démarche de recherche. On appelle tiers secteur de la recherche l'ensemble de ces groupes qui mènent des recherches dans un contexte non académique.
La définition donnée par l'Université de Rennes 2 à l'occasion d'une journée d'étude tenue en 2021 sur le sujet est éclairante :
Le “tiers secteur de la recherche” désigne les activités de recherche, d'innovation, de production de savoirs et de connaissances du secteur non marchand (associations, syndicats, collectivités territoriales, etc.), du secteur marchand à but non lucratif (économie sociale et solidaire, groupements professionnels, etc.) et des organisations à but lucratif de petite taille (auto-entrepreneurs, groupements agricoles ou artisanaux, etc.).
Ces groupes sont d'une part déjà mobilisés et d'autre part déjà actifs en terme de recherche. Leur travail avec le secteur académique, en d'autres termes l'ESR, relève du partenariat. Celui-ci est d'ailleurs fortement plébiscité dans les appels à projets pour financements ANR et Horizon Europe, mais aussi au niveau régional.
-
Exemple de critères d'éligibilité d'un appel à projet régional
Dans l'appel du programme Recherche et Société de la Région Bretagne, on trouve la question du partenariat et de sa modalité comme critère d'éligibilité du projet.
Ainsi il est dit que sont éligibles "les projets portés, a minima, par une actrice ou un acteur de la recherche et une actrice ou un acteur de la société civile".
Sont non éligibles :
- "Les projets de science participative" (projets non co-construits avec les citoyens) ;
- "Les projets poursuivant un but lucratif direct" ;
- "Les projets de recherche scientifique sans implication de la société civile, ou les projets ayant uniquement un objectif de formation aux recherches participatives."
On retrouve ici la description du tiers secteur de la recherche, à savoir des groupes de citoyens organisés, sans but lucratif, et porteurs de projets d'innovation sociale, économique, environnementale, etc.
-
Échelle
Pour Wiggins et Crowston le fait que la mobilisation soit bottom-up, soit de la société civile vers le monde académique, en fait des projets qui réussiront mieux s'ils restent à un niveau local. Ils considèrent que le changement d'échelle demande des développements organisationnels très, voire trop, importants.
Il faut faire la différence entre l'échelle d'organisation et l'échelle scientifique. En d'autres termes, un projet scientifique qui a un terrain réduit et local peut néanmoins parvenir à des concepts et des résultats qui dépassent de loin le terrain. Ceci n'est pas remis en cause. En revanche, du point de vue de la participation, ce type de projet relève de pratiques de co-construction.
On construit avec les citoyens les cadres du problème qui sera étudié d'un point de vue scientifique. Ce type d'échange fonctionne mieux avec un groupe restreint et déjà informé et sensibilisé par le problème social et économique qui est l'origine de la mobilisation. En d'autres termes, des locaux.
Néanmoins, ce type de projet peut gagner en échelle, ainsi l'exemple de l'Université Populaire des Parents est aujourd'hui une fédération qui réunit des associations locales, et la fédération coordonne des projets à l'échelle nationale.
-
Passerelles entre l'université et des groupes de citoyens
Dans ce type de projet, où les groupes locaux initiateurs pré-existent au projet académique, le véritable enjeu est de trouver des chercheurs qui puissent s'y engager.
Il existe plusieurs façons de s'associer à des chercheurs pour ce type de projet de recherche quand un groupe local a, ce que Wiggins et Crowston appellent, un "agenda civique", et notamment le fait d'identifier des chercheurs ayant déjà travaillé sur des thématiques proches _quand des chercheurs ne sont pas déjà engagés dans ces groupes locaux.
Par ailleurs, certains projets, comme "Des semences à l'assiette" à l'INRAE sont aujourd'hui reconnus comme des lieux d'écoute et d'attention aux problématiques des personnes concernées. Dans ce projet-même, qui a commencé il y a 20 ans autour du blé et des pâtes, se développe un nouveau projet à l'initiative d'un paysan-boulanger, qui est d'étudier les propriétés digestives des anciennes céréales et des pains que l'on peut produire avec.
Enfin, les universités se mettent à l'écoute de problèmes posés par des groupes de citoyens. Les universités peuvent faire remonter les questionnements des citoyens de sorte de s'en saisir au niveau universitaire. C'est ce qu'à fait dernièrement l'Université de Bordeaux en organisant une journée d'atelier sur les transitions, avec aussi bien des chercheurs que des membres de la société civile, dans le but d'identifier des problèmes mais aussi des pistes de solutions, de sorte de pouvoir orienter certains financements de l'université. L'événement " Première édition des rencontres des Transitions" a été organisé en octobre 2022. Six sujets ont fait l'objet d'un travail en commun :
- Atelier 1 : Comment améliorer la santé des jeunes ?
- Atelier 2 : Comment mettre le numérique au service des transitions ?
- Atelier 3 : Comment produire et accéder à une alimentation bio et locale pour tous ?
- Atelier 4 : Comment la nature peut-elle être une solution en ville ?
- Atelier 5 : Comment rénover et construire des logements frugaux, résilients, durables et bon marché ?
- Atelier 6 : Comment innover et s'approprier les nouvelles mobilités douces ?
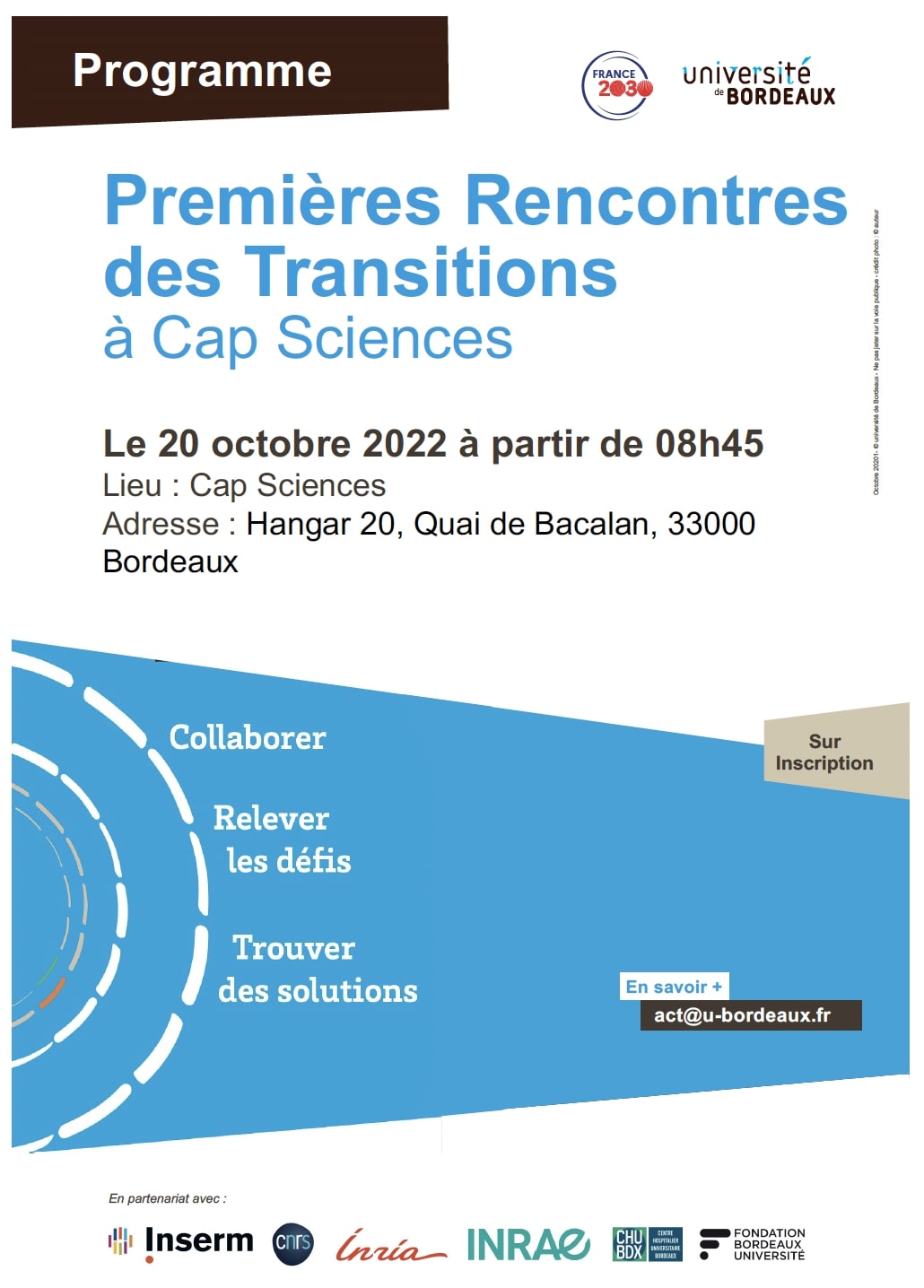
-
L'exemple des boutiques des sciences
L'exemple le plus connu de cette ouverture aux problèmes posés par des groupes de citoyens est celui des Boutiques des sciences, qui sont des espaces dédiés à la recherche participative.
-
Technologie
Pour Wiggins et Crowston, ce type de projet ne demande pas de technologie spécifique ou dans tous les cas pas de technologie trop lourde. En effet, à la fois le niveau local et le nombre de participant réduit rend plus simple et plus directe les interactions et les échanges de données.
Néanmoins, ce type de projet appelle à une attention particulière à la dynamique de groupes et aux échanges et à l'écoute mutuelle pour que la co-construction du projet comme du protocole puisse avoir lieu.
-
Animer un groupe
La question de l'animation du groupe ne repose pas forcément sur le scientifique embarqué dans un tel projet, néanmoins sans une attention à la dynamique qui devra s'installer entre les groupes initiateurs et les universitaires, le projet risque de passer à côté de ce qui en fait sa haute valeur, à savoir une capacité à recueillir et mettre en convergence des savoirs de sources différentes, en d'autres termes :
- des savoirs profanes,
- des savoirs mobilisés,
- des savoirs experts,
- des savoirs scientifiques,
- des savoirs gouvernementaux,
- etc.
-
Enjeux de savoirs
Selon le type de participants, groupe local mobilisé autour de la préservation d'un territoire ou association spécialisée, les savoirs des initiateurs sont différents. Quand les premiers ont un savoir expérientiel et d'usage, les seconds ont un savoir d'expert construit sur une activité déjà forte de production de connaissance, ne serait-ce qu'à travers leurs sites webs. Si le groupe compte également des élus ou des agents des municipalités, d'autres savoirs sont mobilisés : ceux notamment liés aux productions gouvernementales. Evidemment le scientifique arrive avec sa propre panoplie de savoirs et leur spécificité.
-
Godrie, Juan et Carrel, (2022) montrent que les recherche actions participatives reposent sur l'idée de construire des connaissances non pas sur des communautés, mais avec les communautés concernées, comme des acteurs de chaque étape de production de savoirs.
Réhabiliter la dimension située et incorporée des savoirs scientifiques suppose alors de prendre l’expérience comme matériau indispensable dans tout processus de connaissance.
-
Cette expérience permet aux participants de mobiliser des savoirs. Il peut s'agir pour les groupes locaux de leur expérience d'habitants et d'usagers du territoire, ou il peut s'agir pour les associations d'expériences sur les questions :
- médicales, avec des associations de patients, le mouvement féministe, l'épidémiologie populaire...
- environnementales, marquées par des contre-expertises sur la mesure de la radioactivité, des alertes de collectifs de paysans, la mobilisation des ONG pour le climat dans les négociations...
- sociales, où les savoirs des personnes en situation d'extrême pauvreté ou de vulnérabilité sont devenus importants.
-
Croiser l'ensemble de ces savoirs dans un projet participatif demande non seulement une grande reconnaissance de la valeur de ces savoirs, mais encore une attention forte à laisser parler ceux dont les savoirs sont en général considérés comme au pire des non savoirs et au mieux des savoirs de qualité inférieure aux savoirs scientifiques et experts.
Lors du webinaire organisé en 2022 par Jeunes et Recherche Scientifique sur la mobilisation des connaissances, les deux intervenants, spécialistes de la recherche participative, ont insisté sur cette double dimension d'écoute et d'égalité.
Marie-Christine Pitre, agente de planification, programmation et recherche - Transfert des connaissances au CREMIS du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, parle ainsi d'"accueillir d'autres discours : celui des enfants par exemple, celui des minorités".
Et Michel Trépanier, professeur INRS, rappelle que "les points de vue sont égaux ; les savoirs et les savoirs faire des autres participants ont une valeur égale à celui du chercheur.". Il précise que cela ne signifie pas que tous les savoirs sont identiques, mais qu'il y a des "regards particuliers sur un problème" dont il faut tenir compte car "tous ces savoirs sont considérés comme d'égale importance".
-
L'enjeu est fondamental pour la construction du problème, car il s'agit bien d'entendre et de faire place à d'autres voix, d'autres regards sur le problème dont nous allons chercher collectivement à rendre compte.
Dans un article paru en 2022, Godrie, Juan et Carrel insistent également sur l'enjeu de partage des savoirs qui non seulement bouleverse la position habituelle du chercheur, mais bouleverse en cour plus le système de construction et de légitimation de la connaissance en ouvrant à la reconnaissance d'une multiplicité de savoirs, qui sont autant d'intelligibilités sur notre société.
Ce déplacement de l’universitaire solitaire au collectif de co-enquêteurs et coenquêtrices associant divers univers d’expériences s’inscrit dans un mouvement par lequel les savoirs minorisés issus des marges et des périphéries reconquièrent une centralité dans la production de la science et dans l’espace public, passant de l’invisibilité à la visibilité, de la « monoculture de la connaissance » à un régime pluriel de connaissances (Santos, 2017).
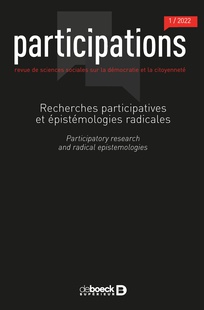
-
Ce type de projet porte donc un enjeu local, un enjeu scientifique, mais aussi un enjeu relatif à l'exercice démocratique, au sens où participer c'est aussi apprendre à s'exprimer, à reconnaître d'autres intelligibilités, à construire au-delà des savoirs qui se rencontrent un projet.
Callon, Lascoumes et Barthes parlent de dialogues à mener autour des controverses (des problèmes de la société) pour construire collectivement et de manière répétée des problèmes scientifiques. Il s'agit de traduire ensemble un problème social en un problème scientifique, qui sera lui-même traduit en un protocole de recherche, puis en des résultats, etc. Callon, Lascoumes et Barthes parlent alors de démocratie dialogique. Les projets que nous décrivons sont des lieux de production de cette démocratie dialogique, à condition d'un travail collectif sur l'écoute et la publicisation des savoirs.
-
Écouter les savoirs
Écouter les savoirs, amener à cette convergence des savoirs, c'est l'objectif de l'animation de groupe. Si celle-ci demande certaines compétences, c'est que l'écoute rencontre un certain nombre de difficultés, qui consistent au fond à une seule et même chose : on ne peut écouter ce qui est tu. Il s'agit donc d'amener les savoirs à être exprimés.
Il existe plusieurs des limitations à la prise de parole, liées au niveau de maîtrise de la langue, à la maîtrise des codes de l'échanges en collectif, à des considérations sur le niveau d'élaboration et d'argumentation (typiquement avec des enfants), etc. Ces limitations sont autant de mépris ressentis, qui bloquent la possibilité d'une prise de parole et d'une écoute réelle des paroles. Ces limitations ont un effet autant sur l'expression (mépris intégré) que sur la réception (mépris dirigé).
(Voir la référence suivante : Raphaëlle Bats, (2019), De la participation à la mobilisation collective : la bibliothèque à la recherche de sa vocation démocratique, Université Paris Diderot).
Parmi ces limitations, celle sur les codes de l'échange collectif est un sujet récurrent des recherches sur la participation. Plusieurs chercheurs comme Tarragoni (2014), Charles (2012) ou Berger (2014) ont montré et critiqué combien les assemblées participatives projettent la réussite de la participation sur la capacité des individus à se dépouiller de leur identité, de leur émotion, de leur colère, etc. L'émotion est considérée, à tort, comme une limite à l'expression comme à la réception des idées et la capacité à contenir cette émotion fait partie des codes relatifs à l'échange en collectivité.
L'émotion est à rattacher au concernement, au fait d'être concerné par l'action discutée. Dans le cas des recherches participatives et des projets de co-construction, ce positionnement personnel de l'individu est au contraire plébiscité. Ainsi, Callon, Lascoumes et Barthes parlent des profanes et de leur identité qui leur donne leur spécificité en tant que profane, parce qu'elle détermine leur niveau de concernement."... l'ouverture aux points de vue et à l'identité des "profanes". Mais pas n'importe lesquels. De ceux, qui à un titre ou un autre, sont concernés par les avancées tatonnantes des connaissances scientifiques dans les domaines qui les concernent en tant que "sujet et objet de la connaissance".
Animer un groupe dans un projet de recherche participative signifiera donc trouver les moyens de faciliter ces expressions, y compris dans leur dimension conflictuelle, émotionnelle, à laquelle nous sommes peu habitués dans le cercle académique.
-
Outils et formations
Pour faciliter la prise de parole plusieurs outils peuvent être utilisés. Les outils de brise-glace sont les outils qui facilitent le contact entre les participants et rendent plus aisés la prise de parole. En voici une liste non commentée. Vous trouverez de nombreuses informations sur le web au sujet de ces techniques.
Photo language : liste ou spontanée
Échelle d'appréciation / humeur
Cadran physique
Se présenter en binôme
Règle
Provenance
Jeux : couleurs, etc.
Récit de soi
Une autre série d'outils est utilisée pour produire des idées et des contenus. Là encore, cette liste n'est pas commentée, tant il existe d'informations disponible en ligne.
Photo language : liste ou spontanée
La rivière du doute
Le mur de post-it / le design thinking
Le photo language
Le world café
Les 5 pourquoi
Groupe charrette ou theme-athon
-
Le Ti'Lab à Rennes, qui est un laboratoire d'innovation publique, a publié un guide très utile pour retrouver les outil utilisables dans les projets participatifs, avec des commentaires sur les modalités d'usage, le matériel nécessaire, les moments clés d'utilisation, etc. Il est accompagné de cartes, faciles à prendre en main, pour animer des ateliers, rencontres, etc.
Le guide Utilo est aujourd'hui une somme incontournable des outils de participation comme le montre le sommaire :
Se rencontrer
- L'intervew croisée
- Crazy jobs
- Le partenaire mystère
Fédérer
- La ronde des compliments
- La constellation
- L'arbre à personnages
Réveiller
- En mouvement
- L'animal imaginaire
Se réunir
- Le stand-up meeting
- le world café
- Le bocal à poissons
S'exprimer
- Le rétro vernissage
- L'article de presse
- Vote par consentement
- Les camelots
S'améliorer
- L'analyse en étoile de mer
- Le futur idéal
- L'évaluation en un mot
- Le CODEV
- Le bateau pirate
Préparer une collaboration
- La cartographie des parties prenantes
- Convergences d'objectifs et réciprocité de projet
- La cartographie des valeurs
Explorer le projet
- Définir votre défi
- La cartographie des savoirs
- Le partage des révélations
Se projeter
- Évaluation des ressources
- Le pont de corde
- La liste des tâches critiques
Comprendre les bénéficiaires
- Les méthodes guerilla
- La visite guidée
- La carte d'empathie
- La carte d'empathie
- Le persona
- Identifiez vos irritants
- Le parcours 1000 bornes
Trouver de nouvelles idées
- Le générateur d'idées nouvelles
- Le jeu des enveloppes
- Le consultant extraordinaire
- Les pires idées
- Le caroussel des idées
- Le Crazy height
Passer de l'idée au concret
- Technique de créativité sans la tête
- Le scénario d'usage
- Le Pecha Kucha
- La product box
Tester
- Anges et démons
- Le focus group
- Les fiches prototype
- Observations sur le vif
Décider
- La fiche critère
- Gomettocratie
- L'école des fans
- La matrice MOSCOW
-
Néanmoins la participation n'est pas un kit (voir l'excellent article à ce sujet de Bonaccorsiet Nonjon, en 2012) à multi usages. Il ne suffit pas d'avoir les outils pour que la parole soit prise. Il est important d'analyser les limites de ces outils. On peut voir à cet égard le travail de Raphaëlle Bats (2020) d'analyse des limites de trois outils de facilitation de la parole : les post-its, le rivières du doute et le portage de parole.
Par ailleurs, il existe des formations pour apprendre à animer des groupes dans des projets participatifs. La plateforme Eu-Citizen Science propose ainsi plus d'une vingtaine de formations sur la participation et son animation, à destination des chercheurs ou des participants.
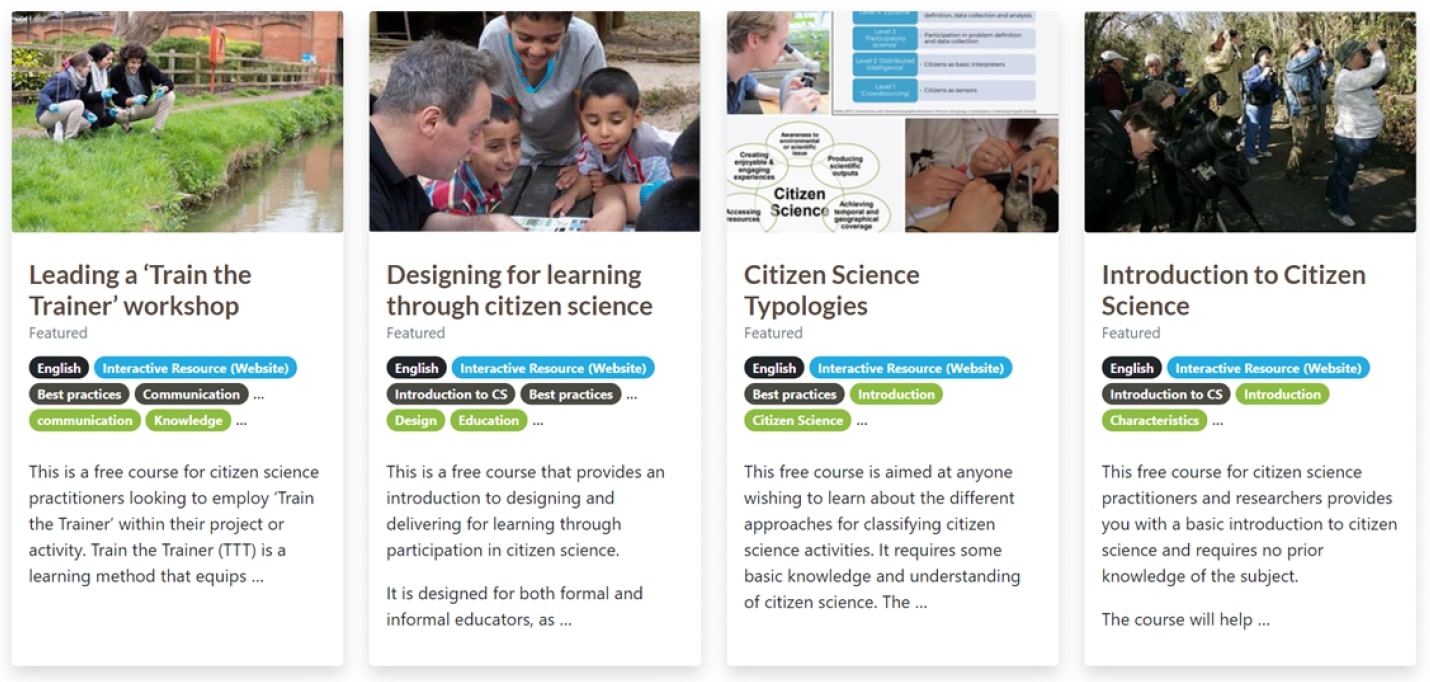
Il est aussi recommandé de s'appuyer sur les compétences de partenaires, qui sont souvent plus aguerris que les chercheurs à ces pratiques :
- Les associations de médiation scientifique
- Les associations spécialisées dans la participation : Sciences Citoyennes par exemple
- Les laboratoires d’innovation sociale des départements ou des régions, comme par exemple le Ti Lab à Rennes, qui développent outils et compétences.
- Les collègues universitaires en design de services publics ou qui ont fait de la participation le cœur de leurs recherches
- Le Museum national d'Histoire Naturelle et Vigie Nature, qui ont une longue expérience de la participation.
- ....
-
Questions éthiques
Ce type de projet pose plusieurs questions éthiques, comme tous les projets participatifs,
dont le principal se rapporte à la question de la neutralité de la science. Ce type de projet n'est pas manifeste d'une science participative, qui serait ouverte à la participation, qu'une science participante, qui est invitée à accompagner des débats publics. De fait ce type de projet se déploie dans un contexte de participation accrue des citoyens au débat public.La participation politique, outre le vote, est inscrite dans les lois depuis 1995 avec le droit de pétition, le référendum local, les budgets participatifs, les consultations locales sur les projets environnementaux, les conventions citoyennes, les concertations citoyennes, le rôle du Centre national du Débat Public (CNDP), etc. Toutes ces pratiques s'inscrivent dans le cadre du développement de la démocratie de proximité et de la démocratie participative et de la décentralisation. En parallèle, le développement d’une démocratie numérique a amplifié la participation des citoyens.
L'apparition du scientifique dans le débat public prend ainsi la forme des projets participatifs, mais pas seulement. Interventions dans les médias, intervention à la demande des gouvernements locaux ou des citoyens, intégration de nouvelles problématiques dans les projets de recherche tout comme l'attention portée à l'ouverture de la science (en termes de diffusion) sont autant de participations possibles des scientifiques à ces débats.
Cette participation n'est pas sans risque pour les scientifiques. Elle peut conduire à une forme
de professionnalisation du scientifique comme expert ou consultant, avec le risque d'instrumentalisation du scientifique et des résultats sur des projets conflictuels. Par ailleurs, un mauvais positionnement du chercheur dans le projet peut accroitre une défiance mutuelle : défiance des habitants envers la pertinence concrète des discours scientifiques et défiance des scientifiques envers la recevabilité des savoirs mobilisés.
Il est donc nécessaire de bien poser dans le projet les limites de l'action et de l'engagement
des chercheurs dans le projet, notamment en matière de déclaration de liens d'intérêt.En 2022, s'est tenu un colloque intitulé "Enjeux éthiques des sciences et recherches participatives", organisé par l'Urfist de Bordeaux, INRAE, le MNHN et l'Université de Bordeaux.
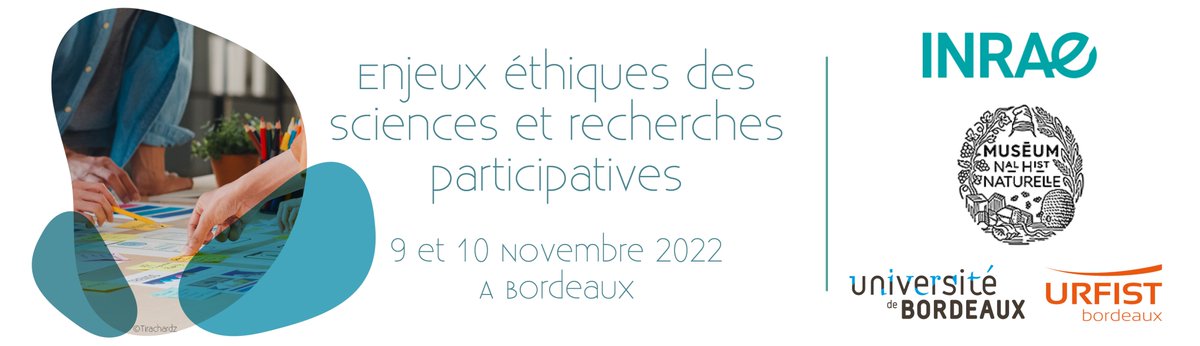
Pendant ce colloque, trois ateliers ont été organisés, dont un sur les enjeux éthiques de ces projets pour les individus : chercheurs comme participants non scientifiques. Trois axes de travail ont été étudiés, dont un sur l'engagement. Les participants à l'atelier ont fait remonter plusieurs pistes de solutions pour éviter ces écueils et risques :
- Clarifier les attentes et motivations des différents participants et fixer les règles du jeu avec les acteurs ;
- Mener des concertations en amont sur les besoins de chacun et discuter tous ensemble de la géométrie variable du cadrage ;
- Créer un comité d'éthique le plus objectif possible pour la concertation/discussion des résultats/définition de l'engagement de chacun ;
- S'autoriser des temps de reconnaissance des contraintes et intérêts de chacun, et du processus de la recherche.
On pourra lire les restitutions brutes de cet atelier et des deux autres (sur les projets et sur les institutions) sur le site du colloque.
Enfin, sur la question plus spécifique de la neutralité des scientifiques, on pourra lire l’enquête menée en 2022 au sein de l’Université de Lausanne : « L’engagement public des universitaires entre liberté académique et déontologie professionnelle. »
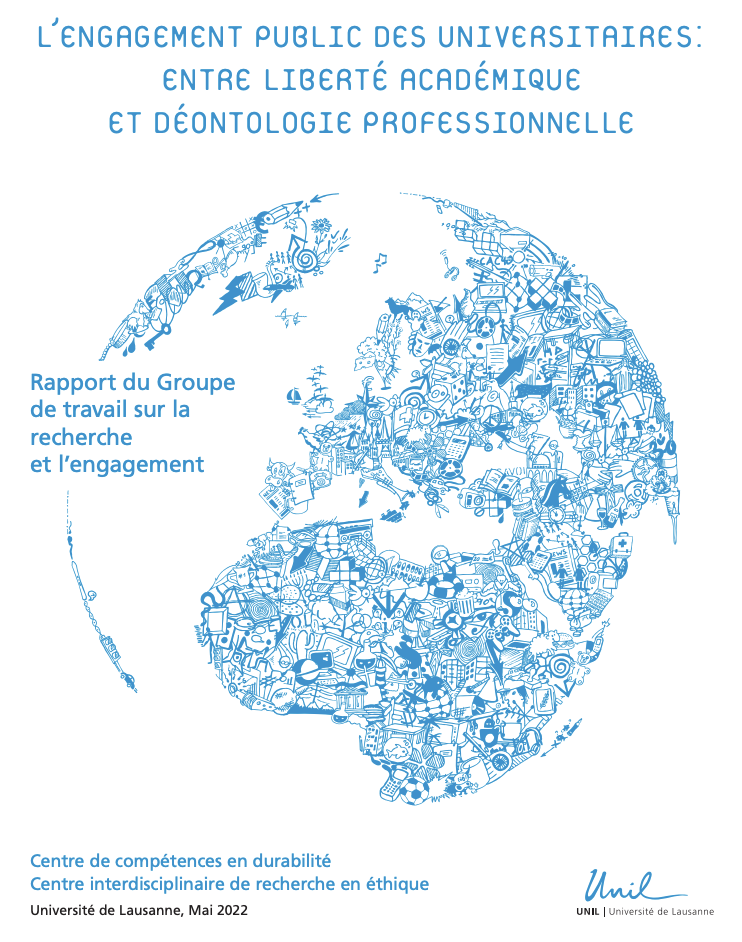
-
En résumé
- Les projets de science citoyenne de type Action locale sont avant tout des projets citoyens soutenus par des expertises scientifiques, comme le montrent les projets Ocean I3, des Semences à l'Assiette ou encore les Universités populaires des parents.
- Ces projets d'action locale nécessitent la mise en place dans les universités de points passerelles entre les mouvements citoyens et les chercheur.ses. Les Boutiques des sciences (Sciences Shops) en sont un exemple.
- Les enjeux d'animation de groupe autour du partage des savoirs et de l'écoute des participants sont au coeur des compétences à maîtriser dans ce type de projets ; des outils et des formations sont à disposition pour les acquérir.
- Les questionnements éthiques doivent être partie intégrante de ce type de projet participatif d'action locale.
-
Quizz
-
