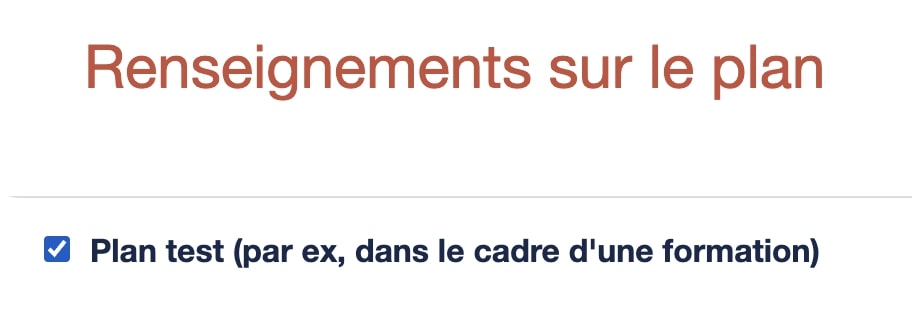Rédiger un DMP pour sa thèse en biologie
Résumé de section
-
Le Data Management Plan (DMP ou PGD pour Plan de Gestion de Données) décrit la gestion des données de recherche tout au long du cycle de vie d'un projet. Il s'agit d'un document obligatoire dans le cadre de recherches sur financement public.
C'est une étape importante qui n'est pas encore ancrée dans les habitudes en biologie, d'autant plus lorsque l'on est en thèse. Ce cours a pour objectif de vous présenter de façon concrète comment se déroule la rédaction d'un DMP dans le cadre d'une thèse en biologie, pour vous initier à cet exercice lorsque vous y serez confronté.
Objectifs
- Identifier les enjeux d'un DMP ;
- Identifier les outils d'aide à la rédaction d'un DMP ;
- Repérer les principales zones à remplir et comprendre à quoi elles servent.

Ce cours est en libre accès !
Aucune création de compte ou d'inscription n'est nécessaire, toutefois vous ne pourrez le parcourir qu'en lecture seule.
Pour participer aux activités (exercices, forum...), vous devez vous inscrire au cours
S'inscrire au cours -
-
Ce forum est disponible pour lancer des discussions entre vous ou poser des questions relatives au cours.
-